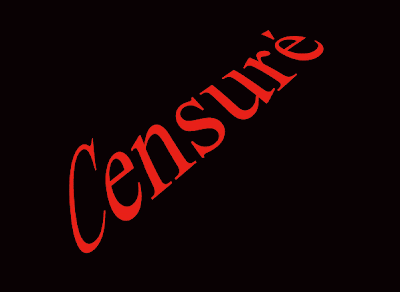Quand l'annexion de la perle du Pacifique
se confond avec la fête
C'est
pour empêcher l'Allemagne de s'approprier les Îles-Sous-Le-Vent avant
la guerre de 1914 que la France et l'Angleterre mirent fin au
Condominium alors en vigueur.
 |
| La mythique Bora Bora vue du ciel |
Ce condominium avait été mis en place après « l’affaire Pritchard » afin que les Îles-Sous-Le-Vent servent de zone tampon entre les zones d’influences française et britannique de l’époque.
La
France s’appropriait les Îles-Du-Vent en plus du reste de la Polynésie
et s’interdisait toute revendication sur les îles devenues anglaises des
Nouvelles-Hébrides.
L'annexion de Raiatea, Taha'a et Huahine
La
prise de possession de ces îles par la France ne repose sur aucune
justification défendable en droit puisqu’elle découle d’un simple accord
bilatéral entre la France et l’Angleterre pour barrer la route à
l'Allemagne. Or, pour empêcher cette dernière de s’approprier
l’archipel, il faut impérativement une présence physique de la
République sur le territoire. Qu’à cela ne tienne : Paris dépêche
l’armée pour instaurer le statut colonial.
A Raiatea, il faut livrer une dure bataille pour vaincre la résistance des autochtones.
A
Tahaa et Huahine, l’affaire est beaucoup plus compliquée. En effet,
fort courageux et sans doute un peu inconscient, le chef Teraiupoo
arrête l’invasion française. Après de nombreux et très meurtriers
combats, la France déporte toute une partie de la population de ces deux
îles aux Marquises. Il faut savoir que la population de cet archipel,
s’élevait à l'époque à quelques centaines d’individus seulement.
Restait à annexer Bora Bora…
Les préparatifs de la reine Teriimaevarua II
La
tragédie qui a ensanglanté Tahaa et Huahine terrorise les habitants de
l’île autant que la reine. Cette dernière n’a pas l’intention de se
laisser faire sans lutter, suivant en cela l’exemple du chef Teraiupoo.
Teriimaevarua
II décrète donc la mobilisation de toutes les troupes disponibles sur
Bora Bora et rassemble son armée sur la place de Taamotu, aujourd’hui le
village de Vaitape. Hélas, ces valeureux soldats sont incapables de
seulement marcher au pas !
En
désespoir de cause, la reine décide d’installer ses troupes sur les
hauteurs de la vallée de Faanui, dans la forteresse naturelle de Pare.
Entouré
de précipices, ce plateau se niche au pied du mont Otemanu. L’endroit
n’est accessible que par un étroit chemin de crête entre Faanui et
Anaau. Pour plus de sécurité, Teriimaevarua II y a fait ériger des murs
de pierres afin de barrer le passage et servir de postes de tir au
fusil.
Ces «fortifications» sont encore visibles pour qui sait regarder. C’est là que la reine a choisit d’attendre l’ennemi français.
La marine nationale française débarque à Bora Bora
Pendant
que la reine Teriimaevarua II prépare son armée au combat la marine
française, après avoir débarqué des troupes à Raiatea, fait route vers
la perle du Pacifique (qui ne porte pas encore ce nom à l’époque).
Etonnamment:
une seule baleinière se détache du navire de guerre et s’apprête à
accoster à Taamotu. A son bord, des soldats français bien sûr. Mais
surprise: à la proue de l’embarcation est attaché un tonneau de vin!
En fait, les militaires viennent en amis, une amitié qui date du roi Tapoa II. Tapoa II et son épouse, Pomare Vahine IV, sont les parents faamu (adoptifs) de Teriimaevarua II. Mais la reine en titre ne sait rien de cette amitié…
Entourée
de son armée de braves elle observe ce débarquement depuis sa
forteresse naturelle, alors que la population de Taamotu accueille avec
chaleur les passagers de la chaloupe.
La bataille de Bora Bora
La
barrique de vin est vite déchargée et, au milieu des embrassades
amicales, les insulaires apportent sur la plage, urus et bananes pour
accompagner le vin, tambours et to’ere pour faire danser tout le monde.
Nous sommes en Polynésie et, ici, l’accueil n’est pas un vain mot… La bringue (la fête) commence et gagne tout le village.
Cantonnés sur le Pare, les soldats de la reine entendent les «dum… dum… dum…»
des percussions. Ils ne peuvent qu’imaginer la fête. La fête et leurs
vahines dansant et buvant avec ces cochons de Français ! Cela n’est pas
supportable.
Un
à un, ils abandonnent leurs postes de combat et descendent vers le
village… Une fois revenus dans Taamotu, il ne leur faut pas longtemps
pour être gagnés par l’euphorie générale et se mêler à la bringue.
Abandonnée
de tous, la reine Teriimaevarua II finit par rejoindre la fête.
Accueillie selon son rang, tant par les Raromatai que par les soldats
français, on l’installe à la place d’honneur et la fête redouble.
Ainsi s’achève la bataille de Bora Bora.
 |
| Le mont Otemanu, plus haut sommet de Bora Bora |
Mort au champ d’honneur
Cette bataille, sans nul doute l'une des plus belles de l’histoire des hommes, fit quand même une victime.
L’un
des marins français tente de monter à un mât. Hélas ! Totalement ivre,
il n’atteint pas son but, lâche prise et s’écrase sur le pont du navire.
Mort au champ d’honneur, ce marin inconnu est le seul décès imputable à
la bataille de Bora Bora.
Remerciements à Fichaux, un très vieux de Bora Bora